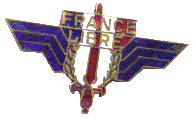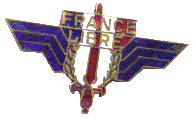| |  | | | | | VNous sommes à 600 mètres du sol. Le pilote pique légèrement pour atteindre la vitesse et l'altitude nécessaires. La visibilité n'est pas excellente, il y a au sol une sorte de brume argentée. Mais, en suivant des yeux la ligne électrique, je distingue à 800 mètres les quatre premiers avions de la formation et, devant eux, la route nationale au bord de laquelle se trouve l'objectif. |
| | J'enclenche l'émetteur de radiophonie ; les appareils qui me suivent entendront ainsi mes corrections et obéiront aux indications que je donnerai pour assurer l'exactitude du tir ; pour la commodité, nous avons adopté entre nous la routine et le vocabulaire anglais "Right... left-left..., steady..., left-left..., steady".
Une lumière rouge s'allume devant moi ; Langer a donc ouvert les panneaux de la soute à bombes. Il s'attache en même temps à respecter scrupuleusement la vitesse et la hauteur prescrites.
En même temps, nos deux boites se serrent ; elles doivent défiler en deux vagues de quatre avions sur la Centrale qui n'a que 150 mètres de large.
Nous sommes pris à parti par un feu nourri de mitrailleuses et de canons de 88. Les canons tirent trop haut ; au-dessus de nous, le ciel se remplit de flocons noirs et épais qui flottent doucement avant de se dissiper. Les mitrailleuses sont plus dangereuses. Leur tir vient de face ; l'objectif est bien défendu. Mais plus question de pratiquer les ondulations classiques par lesquelles les avions déroutent ceux qui les visent, plus question de sécurité ; il faut faire un bombardement correct et éviter d'atteindre ces bâtiments d'habitation, ces cités populeuses qui sont devant nous, juste après l'objectif. Une bombe "trop longue" irait là-bas et tuerait des Français.
Les observateurs, derrière moi, vont tirer à mon signal avec un léger retard ; leurs bombes dépasseront les miennes, il faut que je vise court.
Les quatre avions de tête ont déjà lâché leurs bombes. En faisant ma visée, je ne quitte pas l'objectif des yeux. Trois ou quatre petits bâtiments ; à côté, des pylônes métalliques, avec un enchevêtrement confus de gros câbles noirs. Les premières bombes ont provoqué d'abord des courts-circuits et des étincelles, il y en avait partout à la fois ; certaines étaient rouge-banc, et, d'autres, pourpres presque sombres ; à droite une fumée épaisse commence à se dégager ; puis, tout à coup, à gauche, une violente explosion avec une immense gerbe de flammes oranges. Tout cela se produit en quelques dixièmes de seconde et avant même que l'angle gauche du refroidisseur que je dois viser soit venu se placer entre les deux pointes de mon viseur.
"Right..., steady..., steady..." |
* Par la photographie, nous avons su, le soir même, qu'aucune de nos bombes n'avait dépassé la Route Nationale et atteint le quartier habité du Chemin Vert ; et que l'objectif avait été entièrement détruit. | | L'y voici presque. Je presse vivement quatre fois sur le bouton qui va libérer les bombes, en comptant à voix haute (*). Dès qu'il entend le chiffre " quatre ", le pilote sait que le bombardement est terminé ; alors ce n'est plus moi qui dirige la manoeuvre, c'est lui. Il reprend les evasive actions et pique pour échapper au tir concentré qui nous entoure. (J'étais tellement absorbé, tellement préoccupé par mon travail, que je n'ai pas eu conscience du barrage épais de D.C.A., que les camarades me décriront par la suite).
Les panneaux de la soute à bombes se referment. Les huit avions piquent en même temps vers le sol, en cherchant à reconstituer la formation.
- Ou sont les avions de la première " boite ", mon capitaine ?
- Prenez cap 042°. Ils doivent être loin devant nous au ras des maisons, au-dessous de ces cheminées d'usines, là-bas vers la gauche.
Le Badin dépasse 500 kilomètres à l'heure. Je fouille fébrilement des yeux les toits et le ciel devant moi. Presque aussitôt, je retrouve les avions que je cherchais. Il n'y en a plus que trois ; et l'un est en difficulté, son moteur droit lâche une épaisse fumée noire. En même temps, le radio-mitrailleur annonce qu'un Boston en flammes s'éloigne de la formation les deux moteurs stoppés et que, fidèle à la consigne, il se jette dans la Seine (*). |
* C'est l'avion H. Les quatre membres de l'équipage ont péri. (Lieutenant Lamy, S/C. Roussarie, Adjudant Balcaen, Sgt Jouniaux). | | |
* De son vrai nom, Jean d'Astier de la Vigerie | | L'avion endommagé, devant nous, perd de la vitesse. C'est le G, pilote Lucchesi,  observateur Baralier (*). Les panneaux sont restés ouverts, cause supplémentaire de ralentissement. Deux fois, en phonie, je le leur signale, ils ne répondent pas. observateur Baralier (*). Les panneaux sont restés ouverts, cause supplémentaire de ralentissement. Deux fois, en phonie, je le leur signale, ils ne répondent pas.
Le dernier avion, à droite, survole exactement le confluent de la Seine et de la Marne ; la formation se reconstitue sur une assez grande ligne assez espacée avec dix avions de front et le onzième, le G, à la traîne. Lucchesi a maîtrisé l'incendie, mais son moteur atteint est stoppé ; l'hélice est en drapeau. Pourra-t-il nous suivre ? |
| | Nous sommes sur Paris. L'avion du colonel traverse en oblique le quartier des Gobelins, puis Reuilly ; il va passer près de la place de la Nation, en direction approximative du Père-Lachaise. L'autre extrémité de la formation est à 1 kilomètre 1/2 ou 2 de là sur Vincennes, non loin du Zoo. Vers le centre de Paris, il est difficile de distinguer les monuments, les avenues, auxquels j'ai tant pensé depuis ce matin. Nous sommes trop bas (tout à l'heure à 500 mètres, j'aurais mieux vu, mais j'étais si occupé !). Et le brouillard léger, sans empêcher la visibilité verticale, estompe ce qui est au loin. Seulement, en levant les yeux, j'éprouve tout à coup une grande émotion ; dominant les maisons et les toits, émergeant de la brume, le Sacré-Coeur étincelle de blancheur sous le soleil. Je reste ébloui, une longue seconde devant le spectacle splendide.
Je me tourne vers la droite, je distingue très bien le polygone de Vincennes ; au milieu, un match de football, beaucoup de spectateurs, des Allemands ou des Français ? Dans le doute, nos avions n'ont pas mitraillé, on aperçoit soudain le garage, il y a des centaines de voitures, ce devait être des boches. Tant pis.
Quartiers populaires. Un film rapide : des maisons, encore des maisons ; des rues, des rues toutes semblables (dont on voudrait lire les noms sur les plaques bleues aux carrefours); un bistro ; quelques usines ; au milieu d'un carrefour, un agent de police en tenue de drap bleu. Dans l'ensemble, peu de monde ; et je n'ai pas vu un seul uniforme allemand.
A une fenêtre ouverte, parait une jeune femme, attirée peut-être par le bruit des moteurs. A sa mimique, je devine qu'elle a poussé un cri de surprise et de joie. Elle a eu le temps de sourire avant de disparaître derrière moi. Là-bas, au loin, on devine l'aérodrome du Bourget que nous éviterons de survoler. Le G est toujours derrière nous, il nous suit difficilement.
Chemin de fer de Grande-Ceinture. Deux trains sont arrêtés. Effet de notre bombardement ?... Livry. Les maisons sont déjà moins pressées et moins hautes. Subitement, je pense que j'ai oublié de chercher, de regarder la Tour Eiffel. C'est trop bête. Je pourrais encore la voir peut-être, derrière moi, à gauche.
Mais, au moment où je vais essayer de la retrouver dans le lointain, j'entends un appel de Lucchesi au colonel : " Je marche sur un moteur. Je perds de la vitesse. Pouvez-vous m'attendre ? ". Le colonel ralentit immédiatement et peu à peu les autres avions s'alignent sur lui.
Nous ralentissons jusqu'à 350 kilomètres, vitesse dangereusement réduite. En effet, à l'heure actuelle, l'ennemi imagine à peu de chose près, notre route de retour. A chaque instant, ses chasseurs peuvent nous intercepter. Nous entrons dans la période la plus périlleuse de la mission. Il est 14 h.06, nous devrions être à Crèvecoeur dans dix minutes à 400 kilomètres à l'heure, il nous faudrait au moins dix-sept minutes pour y arriver. Or, les chasseurs alliés ne nous attendront pas sept minutes ; et tout retard supplémentaire accroît encore le risque que nous courrons de faire le voyage de retour sans escorte ni protection. Cependant, le colonel n'a pas hésité ; il conserve la vitesse réduite qui doit nous permettre d'entourer les camarades en difficulté. Observateurs et mitrailleurs veillent avec une vigilance plus grande et scrutent, de toutes parts, le ciel qui est peut-être plein d'ennemis. |
* Le Boston G s'écrasera près de Compiègne. Le Lt Lucchesi et le Sgt Manilli réussiront à regagner l'Angleterre trente-six jours après. Le Sgt Godin et le Lt d'Astier de la Vigerie, blessés, sont faits prisonniers. | | Deux, trois, quatre minutes passent. Le G fait savoir qu'il ne peut pas maintenir la vitesse de 350 kilomètres-heure. Il est clair que nous ne le ramènerons pas ; le colonel décide de ne pas exposer inutilement les dix autres avions. Il remet les gaz, part en avant. Nous comprenons tous ce que cela signifie : nous abandonnons le G. Quel sera son sort ? Sera-t-il, proie facile, attaqué et achevé par les chasseurs boches ? Fera-t-il un atterrissage forcé ?
Bauden le suit des yeux le plus longtemps possible et me rend compte : le G vient de franchir une ligne électrique d'extrême justesse, le second moteur doit être atteint aussi (*) |
| |
|  |
|