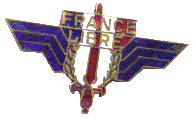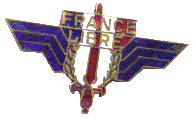Les douze Bostons, en ligne légèrement décalée, volent à 100 mètres du sol à travers la campagne anglaise. Tout à l'heure, sur la France, l'altitude sera de 10 mètre, de 5 mètres, parfois moins ; pour l'instant, il est inutile de fatiguer les pilotes. Il faut seulement voler assez bas pour ne pas être repéré par la radio-location ennemie qui, de l'autre côté de la Manche, surveille sans arrêt les mouvements aériens sur l'Angleterre.
A 50 mètres, à ma droite, vole l'avion de Goldet. Nous resterons aile à aile jusqu'au retour. De temps à autre, nous échangeons un signe rapide avant de nous replonger dans nos cartes.
Il fait très beau ; quelques gros cumulus loin au-dessus de nos têtes, à 1000 mètres. Visibilité excellente. Voici Guildford, Horsham, Hayworth Heath, Hallsham, avec leurs hautes cheminées de briques rouges qui crachent jour et nuit, une épaisse fumée sale ; chacune de ces usines innombrables fabrique des tanks, des camions, des obus ; pas une qui ne travaille pour la guerre. Je vérifie constamment notre vitesse ; le retard s'accroît légèrement, au moins deux minutes, lorsque nous arrivons à la côte.
La mer. Nous volons plus bas, presque à la surface de l'eau. Il y a, sur l'autre rive, des guetteurs. Plus nous sommes bas, plus tard nous serons détectés. La mer, plate comme un lac, file à quelques mètres de nous, à une vitesse vertigineuse.
Derniers préparatifs : les verrous et les crans d'arrêt des mitrailleuses sont enlevés. Les interrupteurs et sélecteurs de l'appareillage de bombardement sont placé en position ; je règle les cadrans et les échelles gradués qui assureront tout à l'heure un tir précis.
Il faut atteindre la côte française exactement au point prévu ; il a été choisi en fonction de la défense ennemie. Une erreur de 2 à 3 kilomètres peut nous conduire sur un nid de Flack. Je prends une dérive ; nous sommes sur la bonne route... plus de nuages ; visibilité presque illimitée.
12h.33, nous devons être à 80 kilomètres de la côte. La vitesse est progressivement accrue et dépasse bientôt 410 kilomètres à l'heure...
Cette ligne, sombre et vague, qui peu à peu émerge au-dessus de l'horizon, c'est la France, c'est mon pays. Comme chaque fois, le coeur battant, je vois se dessiner la figure toujours nouvelle, toujours émouvante de la patrie dont je suis privé depuis si longtemps. De hautes falaises blanchâtres avec quelques fenêtres évasées, des plages étroites, de larges estuaires. Là-bas, à gauche, le Tréport, et l'embouchure de la Bresle ; assez loin, à droite, Dieppe.
Toujours au ras de l'eau, nous approchons de la terre de plus en plus distincte. Devant nous, la falaise semble maintenant verticale ; la formation grimpe brusquement en épousant la forme du sol. En haut de l'obstacle, quelques rafales de mitrailleuses nous saluent. Peu de choses, les informations données étaient bonnes et l'effet de surprise paraît avoir été complet. Nous sommes juste en face du petit village de Biville-sur-Mer, point de repère prévu que nous survolons l'espace d'un éclair, à 13h.32 1/2, avec deux minutes de retard (pourquoi Patureau,  l'observateur du colonel, n'a-t-il pas essayé de les rattraper ?).
l'observateur du colonel, n'a-t-il pas essayé de les rattraper ?).
Nous continuons vers Neufchâtel où nous devons arriver dans cinq minutes exactement. Peu de gens dans la campagne. Il y a six ou huit semaines on achevait la moisson. Dans les champs des hommes, des femmes, des enfants travaillaient. Ils s'arrêtaient à notre approche, reconnaissaient nos cocardes et aussitôt manifestaient leur joie, agitaient leurs chapeaux, leurs bâtons, envoyaient des baisers...
Sur ma carte, je suis pas à pas le sol français qui défile sous mes yeux. Les villages, les hameaux, sont des villages, des hameaux de chez nous. A droite, à gauche, à travers les arbres, au fond des vallées ou en haut des collines ce sont Saint-Martin-la-Campagne, Tourville-la-Chapelle Intraville..., noms charmants, familiers et comme intimes.
Une ligne à haute tension, montée brusque, puis léger piqué, comme on saute une haie, à la course.
Ce pays qui court sous moi, pourquoi est-il plus beau que tous les autres ? J'essaye de définir ce qui le distingue du terroir anglais que je viens de parcourir. Il n'y a pas de différence réelle. Cependant, je le reconnaîtrais entre cent autres Il a un aspect, une atmosphère qui sont de chez nous. Le climat est plus doux, plus tendre. Combien de fois n'avons-nous pas décollé d'une base anglaise, sous un ciel couvert, fermé, épais, pour trouver ici, en France, quelques quarts d'heure après, un soleil magnifique, un air léger et dans toutes choses, la fraîcheur et la douceur de notre pays !
Voici de nouveaux villages avec leurs maisons normandes aux bois bruns et noirs, apparents. Saint-Ouen-sous-Bailly, Auberville et maintenant Neufchâtel (on a regagné une demi minute).
Neufchâtel, son église lourde, la grande place avec ses rangées de barres de fonte auxquelles, les jours de foire, on attache les bètes. Neufchâtel est déjà loin ; nous courons vers Gisors où nous serons dans huit minutes et demie.
Le vent nous dérive un peu en dehors de notre chemin.
Voici Geneviève-en-Bray, près des sources de l'Andelle (existe-t-il, ailleurs qu'en France, des noms aussi gracieux ?).
Des paysans dans un chemin s'arrêtent pour nous regarder, ils nous font de grands signes, en agitant les bras. Ces encouragements, ces approbations, c'est la preuve que nous avons raison, que nous faisons notre devoir.
Nous sommes entre Gournay et Lyons. Voici la célèbre forêt ; nous sommes dans le département de l'Eure, dans mon département. A quelques kilomètres, c'est chez moi ; si, au lieu de coller au sol (au point de frôler par moment les arbres et les maisons), si nous grimpions à 5 ou 600 mètres, je verrais, dans la vallée, derrière la Seine, Louviers, et tout à coté, le petit hameau des Monts avec ma maison, mon jardin, mes pommiers.
Il est 13h.46, nous devrions être à Gisors, mais nous sommes au Sud-Ouest de la ville. Le vent est plus fort que nous ne l'avions prévu et le leader a décidé, sans doute, de rester légèrement à droite de la route prévue. Cela va nous coûter quelques minutes de plus.
Gisors est là-bas, derrière cette crête et ces arbres. Je ne verrai pas sa magnifique cathédrale mutilée. Je ne pourrai chercher parmi ses rues étroites, la maison de Forcinal, déporté par les Allemands dans quelque bagne silésien pour son action patriotique. Cette rivière, c'est l'Epte et, là-bas, doit se trouver Saint-Clair-sur-Epte, cher aux peintres 1900... Une femme dans un champ agite son tablier... A gauche, plus loin, Magny-en-Vexin... Tout est paisible, tranquille, imprégné de souvenirs heureux. Brusquement, quelques salves; nous venons de survoler un nid de mitrailleuse, près d'un aérodrome.
Le département de l'Eure est dépassé. Nous continuons à filer, collés au sol, nous cachant dans les creux, derrière les rideaux d'arbres.
Tantôt, la formation s'étale sur 1 kilomètre 1/2 de largeur et tantôt elle se resserre sur moins de 500 mètres.
13h.51. La Seine est devant nous, large et majestueuse. Une grande ville basse sur les deux rives ; Mantes. Au centre, la cathédrale, somptueuse. Je ne la savais pas aussi imposante, surplombant aussi noblement le fleuve. Le spectacle est très beau, très puissant. Mantes, malgré son surnom, m'avait toujours paru une ville laide. Désormais, je ne la reverrai plus sans évoquer cette découverte splendide, dans la clarté d'un dimanche d'octobre et dans l'écrin de sa vallée et de sa campagne.
C'est sur la région parisienne que nous courons maintenant. Nous serons aux Essarts dans quelques instants. Les bourgs populaires sont nombreux, à notre gauche, mais nous restons autant que possible en dehors des agglomérations. A 13h.55, l'étang des Essarts. Virage accentué vers l'Est. Nous avons fait un assez large détour et nous avons maintenant un retard important, cinq minutes.
Je dois donner aux huit derniers avions le signal de la montée qui précédera immédiatement le bombardement. Il ne s'agît pas de monter bien haut ; 500 mètres seulement ; juste assez pour éviter aux dernières vagues d'être " soufflées " par l'explosion des bombes des quatre avions précédents. (Il y a eu, par le passé, des accidents et nous avons perdus des équipages atteints par l'explosion des bombes de leur propre formation). La montée devait être assez amorcée entre Orsay et Palaiseau, mais nous avons changé de route ; j'ignore l'itinéraire et l'angle d'attaque que Patureau a finalement choisis. Je suis anxieux. Donner prématurément le signal de la montée et obliger les équipages qui me suivent à rester à 500 mètres quelques minutes de trop, c'est les offrir plus longtemps en cible à la D.C.A., dont le tir est précis à cette altitude ; les faire monter trop tard, c'est compromettre le bombardement, c'est risquer de franchir l'objectif trop bas, de subir les effets de l'explosion des première bombes.
Devant moi, l'avion du colonel poursuit sa route, changeant fréquemment de cap pour dérouter ceux qui, du sol, nous surveillent. Nous venons de franchir le chemin de fer de Paris à Chartres, nous sommes dans la vallée de Chevreuse. Je décide de donner maintenant le signal que les autres attendent... Avec un ensemble parfait, les huit Bostons montent pendant une minute. C'est à ce moment que paraissent, venant de la région de Toussus-le-Noble, quelques avions allemands. Un peu d'émotion. A ma grande surprise, ils ne nous attaquent pas et poursuivent leur route.
Le panorama se dégage comme une immense carte étalée sous nos pieds. Ici, la route de Paris à Arpajon ; là, le chemin de fer Grande-Ceinture. Quelques nuages dans le ciel, une légère brume au sol... Voici, devant nous, menant directement à l'objectif, une ligue électrique. Un peu à gauche, la prison de Fresnes ; plus loin, à droite, l'aérodrome d'Orly. (Combien de fois l'ai-je longé avant la guerre, lorsque je me rendais à Melun, à Fontainebleau ou à Orléans ? Jours heureux, jours insouciants. Je voyais, chaque fois, les hangars fameux ; ils n'y sont plus, les Allemands ont dû les faire sauter ; ou bien sont-ils camouflés ? En tous cas je ne les vois pas).
Nous sommes en l'air depuis trois minutes et nous ne lâcherons pas nos bombes avant 30 ou 40 secondes. Nous sommes dans un secteur très défendu. J'ai donné un peu trop tôt le signal de la montée. Je tremble en songeant que l'un des avions qui me suivent peut être attaqué et atteint par ma faute. Paris est tout près, devant moi, à gauche. Si je levais la tête, je verrais la Tour Eiffel et le Panthéon. Mais je n'ose, même pour un dixième de seconde, quitter le sol des yeux ; je ne dois penser qu'à la mission dont l'accomplissement approche enfin.