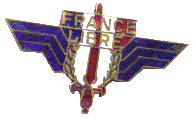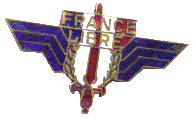| |  | | | | | Is man no more than this ? King Lear. |
| | La rue, bordée de coquettes maisons entourées de jardins, aboutit à un portail, dominé par un bâtiment prolongé de chaque côté par un mur surmonté de barbelés. Sur le portail, une inscription: ARBEIT MACHT FREI. René Bigot nous donne la traduction: le travail rend libre. |
| | Inscription en fer forgé au dessus de la porte du camp de Sachsenhausen.
Photo prise circa 1975. |
| | On franchit la porte. Devant nous une immense place semi-circulaire, bordée par des baraquements, en bois sur socle de béton. Une phrase encadre le demi-cercle - un mot par pignon - Es gibt einen Weg zur Freiheit; seine Meilensteine heissen: Gehorsam, Fleiss, Erlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchterheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland.
René Bigot, toujours obligeant, traduit: "Il y a un chemin vers la liberté; ses bornes milliaires se nomment: obéissance, assiduité, honnêteté, ordre, propreté, sobriété, franchise, sens du sacrifice et amour de la patrie." J'ai déjà entendu ce genre de chose à l'école communale. Il n'y a là rien de révolutionnaire.
"Ruhe!"[1] On reste plantés là, au garde-à-vous, sous le ciel étoilé. Les gros yeux des projecteurs du bâtiment de l'entrée, et ceux des miradors du mur d'enceinte sont fixés sur nous. Les mitrailleuses et les sentinelles qui les accompagnent, aussi. Enfin le jour se lève. J'ai soif, et mes muscles sont impatients de cette longue immobilité.
Los! Los! Vite, vite, il faut aller par là, en rangs. Arrêt devant une baraque. Il faut attendre à l'extérieur. On entre, un à un. Monde hostile. Raymond Fassin, René Bigot et moi, nous essayons de rester ensemble pour y faire face.
Nous passons dans une pièce séparée en deux par de longues tables mises bout à bout. Des Häftlinge[2] sont de l'autre côté. Il faut tout leur donner. Tout. Même les bagues, chevalières ou alliances. Nu - comme un zéro, selon l'expression de ma tante Louise - je passe à la douche. À la sortie, un Häftling muni d'une tondeuse me rase les cheveux, les poils du pubis et des aisselles.
Mémoire d'école communale: on y rasait la tête du pauvre petit porteur de poux, et on l'affublait d'un béret pour retenir les grains de poivre, censés décourager les petites bêtes... Et au cinéma, les forçats ont la tête rasée. Mais je m'endurcis: la mise en scène m'impressionne moins que la première fois, à Miranda de Ebro.
Un autre Häftling, avec une brosse de peintre en bâtiment, qu'il trempe dans un bidon, me badigeonne les endroits rasés d'un liquide qui brûle la peau. Sur le mur, des portraits de poux avec des inscriptions: "Ein Laus, dein Tod[3]". C'est ambigu, on ne sait pas si cela signifie que le pou apporte des maladies mortelles, ou bien qu'on va te tuer si on te trouve porteur d'un pou.
La pièce suivante est un vestiaire. Distribution, au hasard, de loques qu'un clochard jugerait indignes de lui: grands trous découpés dans le dos, rapiécés d'une couleur différente, grandes croix blanches peintes par dessus. Échange rapide entre nous pour essayer de trouver une taille à peu près convenable. Recherche dans un tas - il faut trouver sa pointure pour chacun de ses pieds - d'une paire de brodequins de toile à semelles de bois. Fusslappen: chaussettes russes, un carré de tissu sur lequel on pose le pied, on rabat les coins sur le pied. Plus confortable qu'on ne l'imagine.
Rires inconscients devant le ridicule de ce travestissement. Chacun a peine à reconnaître ses amis, les signes distinctifs ont disparus: vêtements, cheveux, lunettes, bagues... La voix seule vous indique que ce gueux à côté de vous a été votre camarade de cellule. Distribution de numéros, qu'il faut coudre sur le côté gauche de la veste, à la hauteur du coeur: je suis F triangle rouge 97647. |
| | Numéro de détenu cousu sur l'uniforme de l'auteur. |
| | Les rires s'éteignent. Les commentaires révèlent une inquiétude, voire la panique. Etre ainsi privé brutalement de son nom, de son aspect, de celui de ses proches, des points de repère de son environnement familier, dérange l'équilibre. Heureusement, je fonctionne en deux parties: l'une subit les aléas de la vie quotidienne, l'autre, à l'écart, intouchable, lucide, regarde, juge, évalue, se moque et parvient même à rire de l'absurdité de l'horreur... On veut me convaincre que je ne suis rien. Mais moi, je reste moi.
Ils sont plusieurs détenus à parler le français et à répondre à nos questions. Nous sommes au Konzentrationslager[4] de Sachsenhausen-Oranienburg, près de Berlin. Un camp de travail. "Tu as vu l'inscription sur la porte d'entrée: ARBEIT MACHT FREI, le TRAVAIL REND LIBRE? Cela signifie qu'ici tu vas travailler à en crever. Lorsque tu seras mort, on te jettera au four crématoire, dont tu vois la cheminée là-bas, et tu en sortiras petite fumée, enfin libre." Ils exagèrent, et s'amusent à nous faire peur... Sans doute une espèce de bizutage... D'autres affirment que nous avons bien de la chance, que nous sommes ici dans un sanatorium, un vrai camp de vacances... Ils sous-entendent qu'ailleurs il y a bien pire[5]...
On voit peu de SS. Ils se tiennent à distance. Le camp est administré par des détenus. Ceux qui nous encadrent ont l'air bien nourris et sont convenablement habillés, presque élégants; certains ont des uniformes à rayures verticales bleues et grises. D'autres sont vêtus de vestes "civiles" avec, comme les nôtres, un carré de tissu découpé, mais petit, et remplacé par un autre de couleur différente: la cible dorsale est faite avec soin et bon goût, la veste est bien taillée, les couleurs ne jurent pas, comme sur nos loques.
Sur la tête un bonnet rond, "die Mütze" qu'ils ôtent d'un geste emphatique, en criant: "Mützen ab!", chaque fois qu'un SS s'approche. Tous portent sur leur veste le numéro précédé d'un triangle, et parfois d'une lettre.
La couleur du triangle désigne la catégorie où a été placé le détenu. Rouge: politique; vert: droit commun; noir: asocial, c'est-à-dire Tzigane, apatride, maquereau, marginal, etc.; violet: Bibel Forscher (témoin de Jéhovah); rose: homosexuel[6]. Les Juifs ont droit à une étoile jaune, faite de deux triangles jaunes superposés, l'un la pointe en haut, l'autre en bas. Mais on en voit peu: ils ne restent pas longtemps dans ce camp. Les étrangers portent une lettre devant leur triangle. Elle indique la nationalité: F pour les Français.
Los! Los! Schnell! Courir! Par là! Matraques nous poussent vers un portail dans un mur entre deux baraques. L'une est marquée 37, l'autre 38. Un mur à l'autre bout ferme la cour. Zu fünf! Il faut se mettre en rang par cinq. Le portail est fermé derrière nous.
Discours en allemand. Interprète. Celui qui nous parle est le Block-Älteste du Block 37[7], un type grand, triangle vert - donc droit commun - visage grêlé. Nous sommes en quarantaine[8]. Non pas pour protéger le camp contre une épidémie dont nous serions éventuellement porteurs du germe, mais pour nous inculquer la discipline du camp, nous faire comprendre combien est nulle notre importance, et comme est fin le fil qui nous retient à la vie.
"Accroupissez-vous! 'Runter! Pas assis sur les talons! Tendez les bras devant vous! Drecksack!" Et le Kalfaktor polonais de renchérir: "Khourva Jego Mac!" On pourrait se croire, un bref instant, dans une cour d'école, à faire de la gymnastique. Mais voici que ça dérape: le chef de Block se promène entre les rangs et décerne ici et là des coups de son gummi[9]. À ceux qui tiennent mal la position? Qui trichent pour soulager une crampe? Pas du tout, il se promène et frappe selon son bon plaisir. Le temps passe et les muscles deviennent douloureux. Surtout pour les moins jeunes. Murmure de commentaires plaintifs étouffés. "Ruhe da! Mensch! Halte die Schnauze! Perounie!
Première leçon concentrationnaire: le discours n'a aucun lien avec la réalité. "Le travail, c'est la liberté" signifie ici que le travail c'est la mort. Au nom de la discipline, le chef de Block frappe au hasard. Ce camp de travail, que l'on pourrait penser être voué à l'effort de guerre désespéré d'un Reich aux abois sous l'assaut allié, n'est qu'une absurde machine à humilier, à faire souffrir, et à tuer les gens.
"Maintenant, marchez!" Soulagés, on se relève. "Nein! Nein! Kurva jego mac! Marchez comme des crapauds! Scheisskerl!" Accroupis, on se traîne. Certains n'y parviennent pas et vont à quatre pattes. Coups de gummi. "Vous n'aimez pas? Alors, pour vous reposer, vous allez ramper! Allez! Plus bas! Du Drecksau!" De son pied sur leur nuque, le Block-Älteste pousse quelques visages contre la terre. Cyprien me traduit le discours adressé à un haftlinge sous le pied du Chef: "Tu n'es pas né d'une femme, mais d'une bouteille de rhum vide qui traînait dans le ruisseau!" Le Chef rit de l'esprit dont il fait preuve et échange des plaisanteries avec ses Stubendiensts. "Halt! Faites maintenant le crapaud!" On reste accroupis. Les heures passent. J'arrive à m'asseoir sur mes talons sans me faire remarquer.
Un homme par terre, sous le pied d'un autre. J'avais déjà vu ça: Boulevard Emile Augier, dans le 16e arrondissement de Paris, j'étais alors âgé de peut-être neuf ans. L'homme à terre était sans doute un clochard, peut-être soûl ou malade. Debout à côté, un homme en uniforme de chauffeur de maître tenait un discours méprisant, poussait de la pointe de sa botte luisante l'homme prostré et posait son pied sur lui. Scandalisé, j'avais attaqué, de ma première grosse indignation d'enfant, le larbin...
Des volontaires pour aller chercher la soupe et le pain! On va enfin manger? Distribution d'une "Schüssel", une gamelle, en métal, et d'une cuiller, qu'il faudra toujours garder sur soi, et surtout ne pas se faire voler. On fait la queue devant le bidon. Le Kalfaktor plonge sa louche plus ou moins profondément, donc ramène une ration plus ou moins épaisse de soupe de légumes, établissant ainsi une base de troc: "Tu me laves ma chemise et ta soupe sera bonne ce soir", par exemple. Distribution aussi d'un morceau de pain. Trois, quatre cents grammes? La faim est là.
Je peux boire à volonté, et je bois beaucoup. "Ça n'est pas bon", disent-ils, "ça fait gonfler les jambes, etc.". Je n'en crois rien.
(Enfant en vacances en Suisse, on m'avait déjà fait le coup: "Il ne faut pas boire lorsque tu manges des cerises, sinon..." Et j'avais dévoré, dans la chaleur de l'été, des tonnes de cerises arrosées d'hectolitres d'eau. Inquiet, bien sûr, mais les prophéties ne s'étaient pas réalisées).
"Los! Los! Mensch! 'raus!" Coups de gummi pour activer le mouvement. "Zu fünf!" En rang par cinq, on sort du petit camp de quarantaine pour aller sur le bord de la place d'appel, le semi-cercle où nous avions la nuit précédente attendu le lever du jour. "Halt! Stillgestanden![10]"
Des détenus à perte de vue, vingt ou trente mille, la place est pleine: le demi-cercle, plus des prolongements dans les allées entre les Blocks. Au milieu: une espèce de portique, échafaudé au-dessus d'une plate-forme, domine les têtes. Des hauts-parleurs diffusent un discours répété en plusieurs langues. Je distingue mal - basse fidélité et échos brouilleurs - le sens de la version française, mais on y parle de sabotage. Grosse musique lourdaude, jouée par un orchestre de Häftlinge.
Des SS s'agitent autour de la plate-forme. Une demi-douzaine de détenus montent dessus. Trois en redescendent. Trois restent pendus par le cou au portique, agités de soubre-sauts, et meurent, là devant moi. |
| | Potence sur la place d'appel de Sachsenhausen. |
| | Retour au petit camp de quarantaine. C'est enfin l'heure de dormir. Le Block est un long baraquement fait de deux ailes symétriques. A chaque extrémité: un dortoir fait de châlits à trois étages pour cent cinquante détenus. Une paillasse, une couverture. Je prends un lit près d'une fenêtre, que j'ouvre. Déshabillé, mes vêtements et godasses comme oreiller - il faut dormir dessus, sinon on les vole, me dit-on. Quel degré de misère faut-il atteindre pour avoir besoin de voler des loques comme celles que je porte? - je me roule dans ma couverture. Fassin et Bigot sont dans des lits proches, mais je me sens bien seul.
C'est la première fois que je vois de si près des hommes mourir. Que pensaient-ils? Je n'ai vu aucun geste de peur, de protestation ou de défi, mais ils étaient trop loin pour que je voie l'expression des visages... Peut-être étaient-ils soulagés d'échapper à leur enfer? Je me rends compte que je suis pris dans une machine à la puissance infinie, et parfaitement folle. Je n'aime pas la tournure que prend mon aventure. Pourtant, épuisé, je m'endors.
Trois heures quarante-cinq. "Aufstehen! Los! Heraus[11]!" Appel des détenus du Block, dans la nuit noire. Comptage plutôt: personne ne se soucie de votre nom, ni même de votre numéro. Le SS qui vérifie veut que le nombre des détenus y soit, vivants ou morts, ça lui est égal. S'il en est mort dans la nuit, il veut voir les cadavres posés par terre au bout du rang. S'il en manque un, il dira qu'il lui manque "ein Stuck". Enfin: "Genau![12]"
Au centre du Block, en face des portes extérieures, les toilettes. On peut se laver. Les lavabos sont de grandes vasques circulaires d'où jaillissent huit jets d'eau. Pas de savon, l'eau est fraîche. Les chiottes sont dans la pièce attenante: un rang d'une douzaine de sièges en faïence, des détenus assis, d'autres debout attendent qu'une place soit libre. À mon tour: l'idée du contact avec la faïence me révulse, je m'accroupis au-dessus. On pourrait penser que, mangeant si peu, la déjection serait négligeable. Pas du tout: il y a dans ce peu de nourriture une telle proportion de fibres indigestes que les étrons sont étonnamment substantiels et consistants[13].
Il faut faire les lits. "Surtout, qu'ils soient bien au carré!" On se donne du mal. Rassemblement dans la cour. Le chef de Block va inspecter et revient furieux: "Cochons de Français! Pass auf, Mensch! Vous avez fait vos lits comme des porcs! Si vous m'emmerdez, je vais vous faire chier!" La grossièreté lui va bien. Lui et ses acolytes, les Stubendiensts[14] aidés des Kalfaktors[15], en hurlant nous font rentrer dans le dortoir à coups de gummi. Les lits sont parfaits. Que veulent-ils donc de plus? Ils nous chassent du dortoir, puis nous y ramènent, bousculade panique, chacun essayant de forcer son passage pour fuir le gummi frappeur. Ils sont six ou sept par Block, hurlant, frappant à tour de bras. Nous sommes six ou sept cents, troupeau de moutons poursuivis par des chiens. Il faut éviter de se laisser écraser par la cohue. Je suis agile, les coups tombent sur d'autres têtes que la mienne. Mais c'est un jeu de con, ces mecs sont dingues. Heureusement, pour eux aussi c'est fatigant; enfin ils se lassent.
Pause pour le petit déjeuner. Il y a un réfectoire dans chaque aile du Block, entre le dortoir et les toilettes. La chambre du Block-Älteste empiète sur un des réfectoires, celle des deux Stubendiensts sur l'autre. Dans le réfectoire, des tables, des bancs, des armoires. On y apporte les bidons de "café", encore plus nauséabond que celui de la prison de Loos. Ceux qui ont conservé un morceau de pain de la veille, le mangent. Pas mon cas. J'ai faim. Jamais si longtemps ai-je mangé si peu. La faim!
La gymnastique idiote d'hier reprend. Cela s'appelle: "Strafsport", sport de punition: faire le crapaud, ramper, courir. Pause à midi pour une écuelle de soupe, sans doute de légumes: j'y reconnais des tiges de poireaux montés en graine, dures comme du bois.
L'après-midi, au cours d'une séance de crapaud, le Block-Älteste demande s'il y a parmi nous un artiste, un qui sache dessiner. Sans méfiance, un jeune homme lève la main. Il est dessinateur industriel. On ne sait jamais, il y a peut-être une soupe à gagner. Une planche pour s'appuyer, une feuille blanche, un crayon. "Je voudrais que tu fasses le portrait de mon ami. Si tu fais bien, tu auras une soupe en supplément."
Il va chercher son "ami" parmi nous. Il s'agit d'un tailleur lillois, un petit homme, la cinquantaine grisonnante, le dos arrondi par le travail, porteur d'une étoile jaune accolée à son numéro: il a donc commis le crime d'être Juif. Pour son infortune, il ressemble un peu aux caricatures des journaux antisémites. Il est visiblement épeuré.
Le chef de Block est de bonne humeur. Il trouve sa plaisanterie drôle. Les rires serviles des Kalfaktors le lui confirment. Je contemple le dilemme du jeune dessinateur: participer à la persécution d'un de ses camarades, ou subir la colère du chef, dont la voix, devant l'hésitation, prend un ton menaçant. Le portrait est dessiné. Le Block-Älteste est satisfait. L'artiste reçoit sa soupe supplémentaire, et caché dans la foule, la partage avec son modèle. Mais être Juif n'est pas pardonnable, et le petit tailleur à l'étoile jaune disparaît bientôt...
Dans ma tête il y a un coin où s'entassent les mythes dont ma jeunesse a été nourrie, et qui n'ont pas résisté à l'épreuve de la vie: les histoires religieuses, (J'avais fait ma première communion, et je découvre les ceinturons de la Wehrmacht: Gott mit Uns. Qu'est-ce que cette Église dont les prêtres - de chaque côté du front - bénissent et encouragent ses ouailles à s'étriper?), la compétence des supérieurs hiérarchiques, l'invincibilité de l'armée française, le bonheur de mourir pour la patrie, etc.. Voici à présent la supériorité raciale qui s'effondre!
C'était pourtant amusant de descendre les Champs-Elysées, la tête vide, la bouche pleine de slogans: "À bas Blum! À bas les Juifs! À bas les métèques! La France aux Français!" Il y avait là une séduisante rousse, que j'aidais à vendre son journal. Je criais avec elle: "Demandez le Franciste! Organe du fascisme français!"
Des gardiens de la Paix, assis dans leurs autocars, parfois en descendaient et assénaient de grands coups de pèlerines sur les manifestants trop bruyants, qui fuyaient sous l'assaut! Un jour, deux défenseurs de l'ordre m'empoignent et me font monter dans leur car, m'emmènent au commissariat de police, d'où ma mère me sort à onze heures du soir...
À présent que je touche la réalité de la chose, je suis abasourdi par ma stupidité. Sans doute, d'être moi-même désigné comme étant d'une race inférieure[16] m'aide à comprendre l'absurdité, la nocivité de ce racisme, de cet antisémitisme qui a fait partie du paysage où j'ai grandi.
Le Block-Älteste fait sortir des rangs une demi-douzaine de jeunes détenus. J'en suis. Nous serons Kalfaktors, c'est-à-dire bons à tout faire: balayer le Block, nettoyer les chiottes, laver les vitres, le sol, distribuer la soupe, le pain, etc.. C'est une planque: on échappe au Strafsport et on a droit à des suppléments de nourriture.
Ma nouvelle fonction me donne accès à du rab de soupe, assez pour glisser une gamelle pleine à Bigot et à Fassin, pas assez pour d'autres qui m'implorent...
Ça ne dure pas. Je comprends, deux jours plus tard, qu'il y a un prix à payer: il faut "border" le lit du Block-Älteste, c'est pour cela qu'il nous a choisi jeunes. Pas d'accord[17]. Je me retrouve dans la cour à faire le crapaud, encore heureux que le chef de Block ait trouvé ailleurs ce qu'il cherchait et ne ressente point le besoin de soulager sa frustration à coups de gummi sur ma tête.
Visite pour le chef de Block. Un (une?) détenu, foulard rouge sur la tête, rouge à lèvres, entre dans notre cour en minaudant. Triangle rose, donc homosexuel, comment arrive-t-il a se travestir ainsi sans attirer la colère des SS? Il s'entend bien avec son hôte.
Le portail s'ouvre encore: deux SS entrent. Tous les détenus, d'un seul geste, ôtent leur Mütze - cette espèce de béret rond. Le travesti enlève son foulard rouge. Il est chauve et triste. Les SS ne lui prêtent aucune attention. Ils appellent une cinquantaine de numéros et emmènent le groupe ainsi formé. Raymond Fassin est parmi eux. On se regarde, impuissants...
Cela fait un peu plus d'un an que je le connais. Mal, puisque notre travail exigeait le cloisonnement. Je l'avais rencontré à Lyon où il était officier de liaison pour les opérations aériennes auprès du mouvement de résistance COMBAT; j'avais souvent transmis ses télégrammes; il avait un moment chiffré des miens lorsque j'avais maladroitement compromis mon code. Ensemble nous nous sommes envolés sous le nez des Allemands près de Mâcon. À Londres, alors qu'il préparait sa nouvelle mission en France, il m'avait demandé d'être son radio, et ensemble nous avons sauté près de Dijon. Nous avons été cinq mois dans la même prison sans nous voir. J'aime sa lucidité, son calme, son courage. Transport, disent-ils[18].
Récréation: parfois, on nous lâche dans la cour, sans s'occuper de nous. Faire chier les gens est épuisant et notre encadrement a besoin de repos. On marche, on parle. Échange "d'informations", de spéculations, de théories, d'hypothèses, de recettes riches de cuisine et de menus pantagruéliques pour quand on sera libre. Les rumeurs traversent les Blocks 37 et 38: les Alliés sont proches, nous allons être libérés, la Croix-Rouge, les Russes, les Américains, etc., etc.. Est-ce de l'autointoxication, ou est-ce partie du traitement de la quarantaine, injecté par l'ennemi? Pour déstabiliser notre esprit après avoir démoli notre aspect, en attendant d'épuiser notre corps?
Il y a là quelques agents de la France Libre; des résistants; des réfractaires au travail obligatoire en Allemagne; des droits communs; des malchanceux pris au hasard d'une rafle; un poète polonais en mauvais état après son passage aux mains de la gestapo; un comptable lillois qui voit des Alliés partout, pour qui chaque explosion que l'on entend - sans doute en provenance d'un terrain d'essai - au loin de temps à autre est un signe indubitable que nos libérateurs sont là, de l'autre côté du mur; un patron de bordel à qui il manque les dents de devant; un gosse de 16 ans qui n'a pas compris ce qui lui arrivait, et qui veut "rintrer à ch'maison". Et des centaines d'autres, dont jamais je ne saurai rien.
Certains résistent mal, s'évadent dans divers délires. D'autres ont des plaies qui s'infectent; ou la peau des jambes tendue comme une baudruche trop gonflée, rouge, se fissure et suinte. Tous sont tourmentés par la faim.
Au-dessus de nos têtes volent des appareils étranges: avions triangulaires propulsés comme des fusées, ou remorqués par d'autres avions; des bimoteurs au bruit inouï, sinistre[19]. Sont-ce là les armes secrètes dont se vantait mon interrogateur à Loos?
Un Häftling bien habillé entre dans la cour, parle au chef de Block, qui appelle mon numéro. Angoisse. On m'emmène jusqu'à la porte du camp. On m'introduit dans un bureau. Trois hommes sont là. L'un d'eux ressemble à Paarman, du SD de Lille. L'angoisse monte d'un cran. Il ne me donne aucun signe de reconnaître le radio JEANNOT, à qui il avait parlé cinq minutes sur la passerelle de la prison de Loos, peu après le bombardement de Pâques. Il faut dire que le Häftling que je suis devenu ne lui ressemble guère. |
| | Menaçant: "Vous êtes ici sous un faux nom!" - "Oui, c'est celui de mes faux papiers d'identité." - "Pourquoi?" - "L'officier qui m'interrogeait m'a dit le préférer ainsi, mais je ne sais pas pourquoi." Et je lui donne mon vrai nom. Lui aussi veut savoir pourquoi je suis contre son Reich. "Oh, vous savez, ça se fait comme ça, on suit les autres sans trop savoir...Vous auriez fait la même chose si c'était moi en occupation chez vous..." Comme toujours je suis un jeune garçon bien franc, un peu dépassé par les événements. Pas question de radio. Les dossiers ne seraient pas arrivés de Lille? On me renvoie dans le petit camp de la Quarantaine.
"Demain, vous irez travailler au Kommando Kartoffel, décharger des patates. C'est un bon Kommando, on y mange bien".
"Im Gleichschritt! Links! Links!" On sort, le matin, au pas, d'une démarche rigide de pantins donnée par les semelles de bois, hors de notre enclos des Blocks 37/38, puis du camp lui-même. Sous la poterne un SS nous compte. Il faut tourner la tête vers lui, et enlever le béret: "Augen... rechts! Mützen... ab!" On tourne vers la gauche.
Un champ au bord d'une voie de chemin de fer. Un train, ses wagons pleins de pommes de terre, qu'il s'agit pour nous de transporter à l'aide de bards jusqu'à leurs silos alignés. René Bigot est dans le brancard avant, moi dans celui de l'arrière. Des Ukrainiens, des Polonais dans le wagon: "Da vaï! Da vaï! Idi souda! Bistro! Kartochka holen![20] Kourva jego mac!" Ils chargent notre caisse, trouvent drôle de la surcharger. On proteste. Gueulards, ils se moquent, méprisants: "Franzoze immer fick fick machen[21]! Pizda!" Un Vorarbeiter[22] s'approche. Nous sommes au point le plus bas du rapport de force, face à l'extrémité frappante du gummi, donc nous avons tort. On empoigne les brancards et on file. Au deuxième voyage nous avons l'esprit d'esquiver la surcharge, sous les quolibets.
A midi, soupe mince, comme d'habitude. Et l'orgie promise de pommes de terre? "Bist du verrückt, Mensch?[23]" Tintin. C'est pour les Ukrainiens, qui montent une garde féroce autour de leur marmite. Le soir nous rentrons recrus au Block de quarantaine. Le train a été vidé de ses patates, nous n'y retournerons pas.
Arbeit macht frei.
La quarantaine est terminée. Nous allons dans le grand camp. René Bigot et moi sommes affectés à des Blocks différents. Il est au Block 27[24], je suis au 46. Le Block-Älteste est Allemand, à triangle vert. C'est un gros homme à l'air brutal. Etre gras en camp de concentration, c'est comme être propriétaire d'une Rolls-Royce. Il appelle des numéros, arrive au mien et annonce qu'il me faudra demain aller travailler au Kommando Lehnitz.
Trois heures quarante cinq. Aufstehen! Vite faire son lit et sortir pour l'appel du Block. Le chef compte, un SS vérifie. Gamelle de "café". Toilette. Deuxième appel sur la grande place, où je cherche et rejoint le Kommando Lehnitz. Son Vorarbeiter coche mon numéro sur sa liste.
L'Appellplatz est pleine. La totalité de la population - sauf les morts de la nuit entassés sur la charrette du crématorium, et les malades autorisés à aller à l'infirmerie - attend, sous la lumière des projecteurs, le départ pour le travail, alors que les SS comptent et recomptent. Il faut qu'ils tombent juste: A voir le temps que cela leur demande, leurs nombreuses erreurs, il est évident que l'on peut appartenir à la race des seigneurs sans pour autant savoir trop bien compter.
Première lueur de l'aube. Lehnitz se met en branle, démarche rigide, clop-clop des semelles de bois, bras fixes le long du corps: "Augen... links! Mützen... ab[25]!" encadré de SS, fusil ou mitraillette sous le bras - Eins! Zwo! Drei! Vier! Links! Links[26]! rythme la sortie au pas[27] du camp - prend la première route à gauche. Un peu plus loin, un embarcadère avec, amarré, une espèce de bateau-mouche. On monte à bord. Un homme d'équipage largue les haussières. Suite de canaux et de petits lacs.
Sur la droite du canal, on aperçoit une usine, entourée de barbelés et surmontée d'un panneau: AUER[28]. Des silhouettes se déplacent. Lorsque le bateau s'approche, on distingue des robes à rayures grises et bleues. Des femmes concentrationnaires! Un sentiment de sacrilège m'envahit. Des femmes plongées dans cet enfer! Ces salauds jettent la tendresse à la poubelle!
On accoste un peu plus loin, un ponton au bord d'un bois. C'est Lehnitzwald, qui a donné son nom au Kommando. On y construit des maisons avec des matériaux récupérés par d'autres détenus dans les décombres des bombardements à Berlin[29]. Certains font les bûcherons et dégagent les emplacements, d'autres sont terrassiers. Tous les corps de métiers sont là, et déjà deux ou trois maisons sont construites. Je suis dans l'équipe qui décharge les briques des péniches. On fait la chaîne. Je reçois de celui qui est plus bas dans la cale deux briques à la fois, qu'il me faut jeter à celui qui est placé plus haut. Au bout de la chaîne, un wagonnet monté sur rails. Lorsqu'il est plein, il faut le pousser du quai - le point le plus bas - jusqu'au site de la construction. C'est dur. Il arrive que le wagonnet déraille. Il faut alors le décharger, le remettre sur les rails, le recharger, sous la colère du Vorarbeiter, un triangle rouge, pas mauvais bougre, mais obligé de faire un peu de mise en scène pour satisfaire le SS.
L'hiver approche. Parfois il pleut. Voici la neige. Les vêtements sont toujours humides, ils n'ont pas le temps de sécher. La surface des briques est abrasive, le mortier qui y reste attaché est agressif. Il est difficile de se procurer un chiffon pour se protéger les mains. La peau de mes doigts s'use. Je laisse sur les briques des empreintes de sang. |
| | Un kommando redouté du camp de Sachsenhausen, celui de la fabrique Klinker
(l'auteur n'en a pas fait partie). |
| | Veite, le Vorarbeiter des bûcherons, un triangle rouge, a une bonne tête. Un jour il m'offre une louche de soupe: pas de problème, ma cuiller et ma gamelle ne me quittent jamais. C'est gentil de sa part. Le lendemain il me prend dans son équipe. Encore du rab. Je sais à présent ce qu'il veut. Je mange la soupe sans avoir l'air de comprendre. Lorsqu'il me fait signe de le suivre dans un abri souterrain, je fais non de la tête. Le lendemain matin je me retrouve dans la péniche à décharger des briques sous la pluie.
J'ai faim. La tentation est grande de se laisser aller. Mais j'ai compris que je ne survivrai qu'en restant maître de moi. Tout ici est conçu, orienté, pour vous convaincre de votre inexistence, pour démontrer que votre importance est nulle, moindre que celle des briques que vous maniez. Il faut sans cesse se prouver le contraire. C'est moi qui décide des limites que je ne franchirai pas: je ne fouillerai pas les poubelles et je ne vendrai pas mon cul. Et si je dois mourir, je voudrais échapper à ces ordures nazies, et que ce soit de ma main.
Accident: Un jeune Français de l'équipe de Viete a été écrasé par la chute d'une grume qui leur a échappé alors qu'ils la transportaient sur leurs épaules. Il passe près de moi sur une civière de fortune. Je touche sa main, je lui souris: "Courage, ne t'en fais pas. Tu seras bientôt chez toi. - C'est fini pour moi." C'est sans doute lui qui a raison.
Un matin, le bateau est en retard. Il faut attendre près d'une heure debout à l'embarcadère. L'attente, insupportable lorsque j'étais enfant, jeune homme - Les fourmis dans les jambes! L'impatience! - est devenue un délice: une heure à ne rien faire au lieu de manier les briques...
Un soir, le bateau est en panne. Il nous faut rentrer au camp à pied, à travers la campagne, les villages. Des gens nous regardent passer. Pas un signe de pitié, de sympathie, mais ils ne nous jettent pas de pierres.
C'est une longue marche. Les sentinelles qui nous escortent ne sont plus ce qu'elles étaient. Les hommes beaux, grands, forts sont partis pour le front russe, et les uniformes de nos SS flottent à présent sur de pauvres gosses, et sur de vieux machins. Celui qui marche à côté de moi a le visage défait, a envie de parler: il est originaire de Hambourg, et il vient d'apprendre que sa maison, avec sa femme et ses enfants dedans, a brûlé. "Alles kaput!" En Lagerdeutsch, cet espèce de sabir qui a cours dans le camp, je fais tout en marchant des bruits de sympathie un peu défaitistes - Krieg scheisse! - mais ça chatouille mon sens de l'humour d'être en mesure de consoler un SS qui pleure, même si celui-ci est un peu défraîchi.
La vie au Block 46 s'écoule sans trop d'accrocs. L'Allemand vert, notre chef, est une fripouille, mais comme je ne possède rien, je ne fais pas partie de ses cibles. Son Kalfaktor, un Allemand, vert aussi, jeune et dodu, est un salaud sadique. Il boite, et sans doute se venge de sa claudication en frappant qui bon lui semble, sous l'oeil indulgent de son protecteur, qui l'engraisse avec la bouffe prélevée sur les rations des autres.
Mon voisin vient de rentrer au dortoir, le visage blanc, avec des traces de larmes. Il peut à peine marcher. Il travaille sur une machine-outil, dont les vibrations ont déséquilibré sa gamelle posée dessus. Coincée dans la machine il n'est pas parvenu à la dégager avant qu'un SS ne passe par là. C'est étiqueté "sabotage" et passible de pendaison. Comme il n'y a pas eu de dégâts, le SS est indulgent: 25 coups de gummi sur les fesses. Il vient de les recevoir.
Miracle. Un colis de la Croix-Rouge à chaque Français. Du chocolat, des sardines, de la pâte de fruit, du tabac. Le Block-Älteste, qui fait la distribution, exige un petit cadeau de chacun. Je lui abandonne une boîte de sardines. "Alors, on n'aime pas son chef de Block? On ne lui donne pas de chocolat?" "Pass du auf![30]" menace le boiteux. Tout à coup je ne comprends plus un mot d'allemand, et en plus je suis très bête. Mais je parviens à protéger mon chocolat des manoeuvres des prédateurs.
Douches, une fois tous les quinze jours. Je contemple ma maigreur, mes cuisses à peine plus grosses que mes bras n'étaient. Eux aussi ont maigri. Mon bassin fait saillie sur mon ventre creux. Je ne pense qu'à manger. Non je ne mangerai pas les épluchures de pommes de terre des poubelles.
Le soir, avant de s'endormir, on élabore des menus. On projette des ripailles. Un copain de Toulouse nous explique le cassoulet. Moi je sais faire les crêpes. Un autre se promet un plat de lentilles, avec un morceau de lard gros comme ça. Lorsque je serai libéré, je mangerai un énorme gigot. Peut-être deux? Va pour deux. Plus jamais de soupe. Ou alors avec beaucoup de pommes de terre et de haricots dedans. Et des morceaux de viande que ma cuiller trouverait au fond. J'ai faim. Manger.
La faim. J'utilisais le même mot, avant la guerre, pour dire que mon appétit était ouvert. Avant le déjeuner. Après une bonne ballade. "Quand est-ce qu'on mange?"
Et la sempiternelle taquinerie vers celui qui demandait: "Qu'est-ce qu'on mange?- "Des ortolans aux ailes de mouches!" La faim était un sujet de plaisanterie.
La faim envahit votre pensée, votre regard: "Ça se mange?" C'est une maladie qui vous ronge, jusqu'à ce que le fardier chargé de cadavres de musulmans, tiré par une dizaine de Häftinge, ramasse votre corps, posé devant le Block pour être pris en compte lors de l'appel du matin. Il ne reste bientôt plus rien de vous que la petite fumée du four crématoire.
Lorsque j'avais cinq ou six ans, ma mère m'avait mis en pension dans une famille, à St Cloud. La dame cueillait la peau du lait qu'elle avait fait bouillir, raclait sur le fond de la casserole les bulles figées par la chaleur, et mettait le tout dans un bocal. Une fois le bocal plein elle ajoutait de la farine, du sucre, de la vanille... Du four sortaient des petits biscuits dorés...
Et les poulets que ma mère faisait rôtir: elle me donnait toujours la cuisse, la peau était croustillante, la chair fondante... Et ceux de l'hôtel du Sauvage, à Tournus... des poulets de Bresse qui tournaient à la broche dans la cheminée, devant notre nez, avant d'être dévorés par Dédé Jarrot, sa bande, et moi... Les tartines du goûter des enfants: "Vous avez droit à du beurre ou à de la confiture sur votre pain, pas les deux", disait la dame... Les éclairs au chocolat du boulanger au coin de la rue Edmond About et de la rue Guy de Maupassant: un gâteau coûtait un franc le dimanche. Si on avait la force d'âme de conserver sa pièce jusqu'au lundi, elle donnait alors droit à trois gâteaux parmi les rassis qui restaient de la veille... Le beurre, les oeufs, les jambons qu'Hugues rapportait du Berry... Manger. La faim me ronge: le travail, le froid, la pluie, la neige aussi.
J'ai la fièvre. Je tousse une toux douloureuse. Est-ce la pleurésie qui se réveille? Je me risque à l'infirmerie. Les médecins sont français, avec un SS sur le dos. Mon cas est bénin, comparé aux malheureux qui m'entourent. Tout ce qu'on peut faire pour moi, c'est de me donner un permis de "Schonung", de repos. Je passe trois jours à l'abri, sans travailler, dans un Block, une espèce de cour des miracles emplie d'éclopés - nous sommes deux par châlit - avant de retourner à Lehnitzwald.
Le camp a la forme d'un triangle équilatéral - 600 mètres de côté, 18 hectares - délimité par une allée sablonneuse, pointillée de panneaux: "Es wird ohne Anruf scharf Geschossen!" avertissant que l'on tirera sans sommation sur celui qui y mettrait le pied. L'allée est bordée d'une haute clôture de barbelés électrifiés, puis d'un chemin de ronde ponctué de miradors - balcons avec projecteurs, mitrailleuses et sentinelles - puis un mur, surmonté de barbelés. Millefeuille mortel souvent contemplé: est-ce que le courant de la clôture est toujours sous tension? Vraiment capable de tuer? Peut-on s'en servir pour échapper à cette non-vie? Je ne voudrais pas tomber entre leurs mains seulement abruti par une décharge électrique, ou blessé par une mitrailleuse...
La tentative de suicide est punie, - sabotage Mensch! - il ne faut pas se rater, si l'on ne veut pas mourir sous les coups de schlague. Le suicide aussi est puni: celui qui se pend la nuit dans le Block met en danger ceux qui dorment autour de son cadavre: ils seront déclarés coupables d'avoir laissé faire et ainsi encouragé le sabotage. Il faut donc, si on veut en finir, trouver le lieu et le moyen de le faire à l'écart et à coup sûr.
Je suis seul. J'ai perdu CYPRIEN[31] - René Bigot. Je rentre si épuisé que je ne vais pas souvent le voir, et c'est pour lui sans doute pareil. Cela fait plusieurs fois que je ne le trouve pas, et que je me fais jeter hors de son Block. Les intrus sont mal vus, surtout aussi loqueteux que moi: "Franzose immer comme-ci comme-ça!" accompagné d'un geste faucheur de la main. Tout le monde sait ça, les Français sont des voleurs. Les Français, eux, savent que ce sont les Polonais, les Russes et les Ukrainiens qui fauchent. C'est sans doute plus vraisemblable, puisque les Européens de l'Est sont, de loin, les plus mal traités - jamais de colis de la Croix-Rouge. Pour les Polonais, mais rarement, un paquet de leur famille. Les détenus plus favorisés qu'eux sont forcément leur cible naturelle.
Racisme endémique entre les diverses nationalités, comme si chacun, du fond de sa misère, avait besoin d'un objet pour exercer son mépris. "Franzose immer fickfick machen!" Les Français sont des baiseurs! Mon dieu, je voudrais bien. La faim, la fatigue, le froid, le manque de sommeil épuisent. Je n'ai pas bandé une seule fois depuis mon arrestation, et je vais sans doute mourir ici sans avoir jamais vraiment aimé, et fait l'amour avec celle que j'aime. Celle que j'aime, je ne la connais pas encore, mais j'imagine bien sa main sur mon visage. Cette guerre me fait vraiment chier.
Certains Français, arrivés au camp par les transports précédents, ont formés des petits groupes d'amis qui se connaissent depuis longtemps. Je ne cherche pas trop à m'y introduire ni à me lier. Il me semble que notre convoi est arrivé de Lille sans les dossiers correspondants aux bonshommes, et que personne ici ne sait que je suis un radio de Londres. Ce qui explique sans doute que je sois encore en vie. Et si on se lie, il est difficile de ne pas se raconter.
Comme en prison, les jours coulent sans relief, il n'y a pas d'hier, ni de demain, c'est toujours le même jour. Avec pourtant cette différence: la mort en prison pouvait se présenter n'importe quel matin, sans crier gare, mais ici, en plus, la vie s'en va un peu chaque jour par cet agencement de travail excessif et de nourriture insuffisante. Il suffit de faire en esprit la projection dans l'avenir de cette perte de substance pour comprendre qu'il sera court.
Organisieren, Mensch!
Et pourtant, je me fais un ami[32]. Yuri. Un Polonais, triangle rouge. Il parle le français et un peu l'anglais. C'est l'anglais qui est le point de départ de notre amitié: il est heureux de pouvoir s'exercer. Le dimanche nous nous évadons en longues conversations. Il fait partie de la brigade de Sapeurs-Pompiers du camp, et il loge dans le Block15.
Il s'inquiète de mon mauvais état physique. "Il faut faire quelque chose. Tu ne vas pas durer longtemps dans ce Kommando-là." Au soleil de sa sympathie, je finis par lui dire qui je suis.
Yuri m'explique: "La population du camp est faite d'une grande masse banale, et de deux minorités. L'une est celle des Prominenz, ces gens aux fonctions confortables, mais pleines de danger: ces privilégiés, prédateurs de cette jungle, sont aussi la cible de ceux qui veulent prendre leur place".
"L'autre minorité est celle des Muselmänner[33], les plus miséreux, affreusement maigres, sans force, étirant leurs dernières semaines de vie. Il n'y a aucun risque à voler leur pain, leur ration, à se défouler sur eux, à les laisser mourir dans leur coin, et on ne s'en prive pas. Ils meurent sans faire d'histoires".
"La sécurité se trouve dans la grande masse, avec cette règle d'or: ne pas se faire remarquer. Avec ton costume de clochard et ta maigreur, tu n'es pas loin de basculer et d'être Muselmann. Il faut 'organiser'[34].
Quelle est ma pointure? Le lendemain, le voici avec une paire de brodequins de cuir. J'abandonne sans regret mes galoches de toile et de bois. Et cette veste bien propre, à rayures grises et bleues, me va-t-elle? Comme un gant. Transfert du numéro de ma veste clocharde sur la neuve. Avec mes cheveux qui commencent à repousser, je fais un Häftling très middle-class.
"Maintenant, tu vas aller à l'Arbeitsamt[35] leur demander de changer de Kommando. Que sais-tu faire? - En dehors de la radio, tu sais... - Tu leur dis que tu es ingénieur, et que tu es mal utilisé à décharger des briques. - Tu veux rire? Ça ne marchera jamais! - Tu n'as rien à perdre. Essaie."
Un Belge, triangle rouge, est derrière le comptoir de l'Arbeitsamt. "Que veux-tu? - Je travaille à Lehnitz à décharger des briques, alors que je connais l'électronique." Je n'ai pas le culot de me présenter comme ingénieur. Longs regards. On se pèse. Il ne dit rien, mais inscrit mon numéro.
Trois jours plus tard, sur l'Appellplatz, on crie ce numéro. Il me faut aller par là, avec le Kommando DAW[36]. Je quitte le groupe de Lehnitz sans regret.
La nuit traîne. Sur la base du triangle que forme l'Appelplatz s'élève la grande porte d'entrée, avec son porche, son ARBEIT MACHT FREI, son balcon à projecteurs - gros yeux qui nous hypnotisent dans la nuit glacée - et ses mitrailleuses menaçantes. On attend le lever du jour pour aller travailler. Hiver continental: -10, -15, -20 degrés Celsius. Les SS emmitouflés comptent et recomptent. Lorsqu'ils ne sont pas trop proches - on est censé rester au garde-à-vous - on se dandine d'un pied sur l'autre, plantigrades qui essaient de faire circuler leur sang.
Chaussures, chaussettes russes, un caleçon long, un pantalon, une chemise, une veste, un béret - les tissus en fibres artificielles: pur acajou massif, disait le chansonnier Jean Rigaux à Paris, se moquant des vêtements fabriqués à partir de fibres de bois - rien d'autre n'est permis pour se défendre du froid. Mais je triche: deux feuilles de papier journal - organiseiren, Mensch! - sous ma chemise, m'isolent un peu du froid. Comme je n'ai aucun moyen officiel de me les procurer, je risque, si découvert, quinze coups de gummi sur le cul, puisque j'ai volé.
Altercation. Un Prominente s'en prend, dans mon rang, à un Häftling. Il le frappe au visage de ses poings gantés de cuir et éructe un allemand rauque que je ne comprends pas. Sans doute des reproches, des insultes. Le sang coule du nez et de la bouche du prisonnier qui reste au garde-à-vous. Puis s'écroule. Le Prominente s'en va.
L'aube arrive enfin. Le Kommando DAW - Mutzen...ab! Eins! Zwo! Drei! Vier! Links! Links! - sort du camp, tourne à droite, à droite encore, autour d'un angle du triangle que forme le camp. Une grande cour, des machines, du bois empilé, des tas de sciure. Bureau. Un détenu, vieil Allemand, triangle rouge, me dit que les plus hautes sommités scientifiques d'Europe se trouvent dans son Kommando, et que c'est un grand privilège d'y être admis. Je n'en doute pas. Inquiet: jamais je ne pourrais cacher mon ignorance aux regards de tels savants!
DAW est une entreprise de menuiserie. Mais dans un recoin de la cour, près du mur qui la sépare du grand camp, se trouve un petit sous-Kommando, installé dans une baraque en bois, où l'on récupère du matériel électronique pour la firme Siemens[37]. Je monte trois marches et j'entre dans un atelier. Des travées, des tables et des bancs, quelques hommes y sont assis. Il fait chaud. Au fond de l'atelier, un Kalfaktor soigne un poêle à sciure.
Le Vorarbeiter m'installe aimablement à une table. À côté de moi, une caisse pleine de lampes de TSF, du type miniature utilisé en ondes très courtes[38]. Ces lampes sont mortes. Il s'agit d'en briser l'enveloppe de verre avec un petit marteau, d'en couper, avec une petite pince coupante, les divers éléments: filament, cathode, grille et plaque, puis, à l'aide d'une petite pince à long nez, de les répartir dans les boîtes appropriées. Ce sont des métaux précieux pour l'effort de guerre.
Le Vorarbeiter est Allemand, triangle rouge. Il se nomme Émile. Il parle bien le français, avec un accent épais comme de la choucroute. C'est un ancien des Brigades Internationales. Il a les mains baladeuses, et aime bien me caresser le cou lorsqu'il passe derrière moi au cours de ses rondes de surveillance, mais ça ne va pas plus loin. Heureusement, car je ne suis pas sûr d'avoir encore la force d'âme nécessaire à la sauvegarde de ma vertu, si le prix doit en être le rejet de ce Kommando qui me sauve la vie.
Je suis assis toute la journée, au chaud, entouré de gens qui ont reconstitué autour d'eux une bulle de civilisation. Personne ne crie, personne ne frappe - Prosze Pana![39]- tous parlent courtoisement. Le travail est léger. On voit un SS tous les quinze jours, il passe en coup de vent. J'ai toujours faim et je reste maigre. Mais cette brèche par où s'écoulait ma vie, le déchargement des briques sous la pluie, la neige, et au vent froid, est colmatée.
Mes deux voisins, à droite et à gauche, sont Tchèques, l'un parle le français. Il tient un journal qu'il cache dans le mur de notre atelier. Il organise une ration supplémentaire de pain, qu'il mange tranquillement à sa table de travail, après en avoir soigneusement découpé la croûte, qu'il n'aime pas et me donne. Ça doit bien me faire 50 ou 75 grammes de plus.
Le Kalfaktor surveille la gamelle du Vorarbeiter, et deux ou trois autres qui chauffent sur le poêle. Éclat de rire dans l'atelier: Un Polonais, brave gars, mais pas une lumière, à qui le contremaître vient de demander de lui faire chauffer de l'eau, vient de remplir un seau en bois qu'il a posé sur le poêle. |
| | Voici que j'ai le temps et l'énergie de regarder autour de moi et de penser à autre chose qu'à la survie immédiate. Et surtout j'ai un ami! Comment exprimer cela? Dans ce monde qui n'est à chaque instant du jour et de la nuit qu'hostilité, brutalité, férocité, méchanceté, absurdité, danger, tout à coup on dit pouce! Je rencontre au détour d'une baraque un type qui me donne envie de sourire, avec qui je puis rire et parler sans avoir peur de ce que je pourrais dire...
Yuri m'emmène parfois à travers le camp. Dans le triangle qu'il forme: environ 70 Blocks, des châlits pour 25 000 détenus - mais lorsque besoin est, on n'hésite pas a en mettre deux par lit, ou davantage. Quelques Blocks spécialisés. La cuisine, les douches, l'infirmerie, et un Block[40] qui sert à faire des "expériences" sur les détenus. D'autres Blocks encore, mystérieux, dont Yuri ne tient pas à parler[41].
Parmi les aménités du camp: un bordel. Les pensionnaires sont des détenues. À l'usage des Prominenz, évidemment. Pour le tout venant, l'idée d'aller au bordel serait risible, si leur sens de l'humour avait survécu à la faim.
Le Block 15, pour les diplomates, les musiciens de l'orchestre du camp, les Sapeurs-Pompiers - Yuri en fait parti - les pasteurs et les prêtres à la condition privilégiée: peu de travail, nourriture plus raisonnable, pourvu qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux.
Les prêtres... Enfant, il me fallait tous les jeudis aller au catéchisme, tous les dimanches à la messe. J'ai fait ma première communion à l'église de Sèvres. Avant d'en être jugé digne, il fallait passer un examen. Le jour venu, ma mère est venue s'asseoir quelques rangs derrière les enfants: soutien moral. On appelle mon nom. Je réponds bien aux questions, je regarde la note qu'écrit l'examinateur: 5 sur 5. De retour à ma place, tout heureux, je montre à ma mère une main avec les cinq doigts écartés. Le prêtre qui nous surveillait, marchant dans la travée, lisant son bréviaire, me voit du coin de l'oeil et interprète mon signal à ma mère comme étant un acte de vantardise devant mes petits camarades. Il se lance alors dans une dénonciation publique du péché d'orgueil, me montrant en mauvais exemple, et introduisant en moi un des premiers germes de doute: comment le représentant de Dieu sur terre pouvait-il se tromper aussi grossièrement?!
Je n'ai jamais, dans le camp, rencontré ce mythe, le prêtre chrétien qui porte les secours de la religion à son prochain, dit des messes clandestines, etc.. Sans doute parce que celui assez altruiste et naïf pour ainsi exercer son apostolat était aussitôt "libéré" par la cheminée du Krematorium.
Autour de l'Appellplatz tourne en rond tous les jours une file d'hommes, sac lourd au dos. C'est le Schuhe Kommando, des hommes punis qui éprouvent les bottes destinées à la SS. Ils habitent le Sonderlager de la Strafkompanie[42] , petit camp à l'intérieur du grand, où l'on trouve aussi des prisonniers de guerre russes, particulièrement mal traités, et des commandos anglais pris lors d'un raid sur les côtes de la Norvège. Une sentinelle, de la police Häftling, en garde la porte. Un soir, Yuri lui glisse un mot, et nous entrons à l'intérieur. Il me présente aux Anglais[43].
L'Appellplatz est aussi un terrain de football: des équipes de bien-nourris y jouent le dimanche après-midi devant ceux qui ont la force de venir regarder. On y dresse les potences les jours d'exécution publique.
Yuri m'emmène à l'infirmerie, où il me présente à Claude Bourdet, allongé sur un châlit - je connaissais le nom de son père, Edouard, administrateur de la Comédie Française - et aussi à un vieux Norvégien qui nous donne un morceau d'un étrange fromage sucré, qu'il sort d'un colis de la Croix-Rouge norvégienne.
On voit toujours peu de SS. Roués, au lieu d'assurer eux-mêmes l'administration du camp et du travail, ils désignent parmi les détenus le Lagerälteste (chef du camp), les Blockältester (chefs de blocs), les Vorarbeiters (contremaîtres), les Kapos, (flics), tous ceux qui encadrent la population du camp: les Prominenz. À condition d'obéir strictement aux désirs des SS - ou de ne pas se faire prendre à désobéir - les Prominenz bénéficient de privilèges considérables: meilleure et plus abondante nourriture, meilleur habillement, peu de travail. Souvent peu scrupuleux, certains abusent de leurs privilèges et exploitent, parfois littéralement à mort, leurs camarades de détention. Ils commettent, pour conserver leur place, les brutalités que leur commandent les SS, et parfois en rajoutent pour se faire bien voir, ou pour le plaisir de la chose. Mais surtout, ils sont bien placés pour organiser.
Les Prominenz se divisent, en gros, en deux groupes:
1) les triangles verts, droits communs, qui sont plus malléables aux exigences des SS, mais dont l'administration a tendance à déraper vers les abus les plus ubuesques[44].
2) Les triangles rouges, politiques, souvent communistes - beaucoup d'anciens des Brigades Internationales qui avaient combattu aux côtés des antifascistes dans la guerre civile espagnole - dont les SS se méfient, mais qui en général administrent le camp efficacement, sans se laisser aller aux brutalités gratuites ni aux prévarications des triangles verts.
Les "abus" de pouvoir des triangles rouges s'exercent surtout vers la protection de ceux qui ont combattu les nazis. Par exemple l'échange du numéro matricule d'un cadavre anodin avec celui d'un ami que l'on sait particulièrement menacé. Sur les registres les SS constatent que le Résistant, le Communiste qu'ils allaient se faire le plaisir de torturer et tuer, est déjà mort. Ou bien les triangles rouges installent leur protégé dans un Kommando privilégié, où le travail est moins pénible[45].
Accrochés à des mâts, des hauts-parleurs dont la musique triomphante annonce tous les soirs, lorsque nous rentrons du travail, le communiqué de l'OKW[46].
Sur le mur du Block, le Volkischer Beobachter - journal du parti nazi - est affiché tous les jours. On y trouve le même communiqué que celui des hauts-parleurs, accompagné d'une carte. J'y déchiffre les exploits des troupes allemandes héroïques - bien sûr ils gagnent toujours contre un ennemi supérieur en nombre - mais sur la carte, petit à petit, les Russes avancent.
L'avance des Soviétiques fait que l'on replie sur Sachsenhausen la population de camps et de Kommandos plus à l'Est. Nous sommes chaque jour envahis davantage. Il y a même des femmes et des enfants. Tous ont souffert. Certains ont voyagé sur des wagons-plateformes ouverts à la neige. Beaucoup sont morts pendant le transport. Le crématoire fonctionne à plein, et son odeur de chair brûlée s'étale.
Fin janvier, les Russes sont sur l'Oder, à 60 kilomètres. Ce grondement sourd que l'on entend au loin, certains jours, serait-ce le bruit des combats? Debout à côté de moi, un jeune Ukrainien regarde aussi la carte, exprime sa satisfaction, sollicite la mienne. Sa joie devant l'avance des Russes est sans doute réelle. Peut-être cherche-t-il vraiment à la partager? Peut-être est-ce un provocateur? Ma figure en joueur de poker, je ne donne pas prise. Je perd l'occasion de me faire un ami si j'ai tort, je garde ma vie un peu plus longtemps si j'ai raison.
Le chef de Block est plus que jamais vigilant, il va régulièrement à la chasse aux poux. Le détenu grimpe sur un tabouret et baisse culotte. L'inspecteur, une lampe à la main, scrute les recoins, ses plaisanteries scatologiques, les mêmes chaque semaine, provoquent les rires empressés de sa cour. Au suivant!
United States Air Force.
10 avril 1945. Trois heures quarante-cinq. Je rêve de grasses matinées et il faut se lever, sortir sous le ciel étoilé, sans lune, dans l'air glacé. Un jour comme les autres. Mon sommeil lourd, écrasé de fatigue, est presque chaque nuit dérangé par les Anglais qui bombardent avec à présent des bombes énormes qui, depuis Berlin pourtant à 20 kilomètres, secouent mon châlit. L'appel du Block est vite fait: rares sont ceux - SS ou Prominenz - qui maintenant insistent lourdement sur la connerie concentrationnaire, toutes ces petites choses - alignement, silence dans les rangs, immobilité, petit doigt sur la couture du pantalon, lit au carré, mütze ab! - qui permettent d'emmerder au maximum le détenu.
Toilette. "Café". Il me reste un morceau de pain. Je vais vers l'Appellplatz, cernée de ses projecteurs aveuglants. Appel des Kommandos, toujours long: il faut attendre la fin de la nuit. Tous se balancent, d'un pied sur l'autre, lorsque le SS n'est pas trop près. Il faut dire qu'ils sont moins agressifs depuis que les Soviétiques sont proches, mais on ne sait jamais. Première lueur de l'aube, qui lève un petit vent, dernier tour de vis au supplice du froid.
Les premier Kommandos à partir au travail défilent sous le porche, eins! zwo! drei! vier! links! links! rythme lent - klonk! - des semelles de bois, les bras raides le long du corps, Mütze ab! le béret ôté d'un geste d'automate devant le SS qui compte une dernière fois. Nous, on tourne à droite, le long du mur d'enceinte.
Encore une fois à droite pour entrer dans la cour de DAW, les menuisiers vont par là, nous grimpons les trois marches de notre atelier. Le jeune Kalfaktor allume le poêle, ceux qui ont de quoi préparent leur gamelle pour la faire chauffer. Avec mon petit marteau, je casse mes lampes de TSF.
Ciel bleu. Le soleil est déjà haut. Soudain il fait trop chaud. Par la fenêtre ouverte, le Printemps entre, porteur de promesses: l'hiver est en déroute, les nazis aussi. L'atelier est surélevé sur une base de béton, l'air est brillant, nous pouvons voir au loin, par dessus le mur d'enceinte. J'ai envie de courir.
Hurlement. Les sirènes de la Voralarm, la prè-alerte qui annonce l'arrivée des bombardiers - ennemis ou amis suivant le cas de l'auditeur - sur le territoire, et la possibilité de leur visite. On dirait un enfant qui geint, sachant qu'il va prendre une baffe. Rien d'exceptionnel, elle est quasi permanente tellement l'aviation alliée est active. Mais voici la Grossalarm. C'est déjà plus sérieux, c'est l'alerte qui signifie qu'on pourrait bien être la cible, et que les avions ne sont plus loin. Bruits de moteurs qui naissent et se rapprochent, DCA qui jappe. Quel raffut! Tous aux fenêtres. Les avions sont hauts, ils laissent derrière eux une trainée blanche. Ils voyagent en escadrilles de douze appareils, chaque escadrille peint sur le bleu du ciel une bande blanche, comme avec une brosse large de peintre en bâtiment. Ils viennent de tous les points du compas. Le ciel s'embrume, la DCA rageuse le ponctue de ses petits nuages joufflus. Mugissement des bombes en chute libre, fracas des impacts. Au loin, des morceaux de paysage, des bâtiments, se soulèvent vers le ciel, se disloquent et retombent, l'horizon bouillonne. Puis arrivent les grosses gifles du souffle des explosions. Pandémonium. Il me semble que je serais mieux dehors.
Du perron, je vois en l'air le feu d'artifice des containers de bombes incendiaires - multiples petites bombes au magnésium brillant, accrochant la lumière - projetées alentour. Et à terre les Luftschutz[47] qui les recouvrent de sable pour les éteindre. Je pèse le pour et le contre: ferais-je une moindre cible en restant debout, ou en m'allongeant à terre?
Debout, je suis une cible plus petite pour les bombes incendiaires nombreuses mais qui n'éclatent pas. Mais s'il arrive une bombe explosive, j'en prends plein la gueule. Je serais alors mieux allongé par terre. Dilemme.
Les avions sont partis, laissant derrière eux le ciel blanc et la fumée noire. Ici, au Kommando, nous n'avons éte touchés que par des incendiaires, vite éteintes. Ils visaient sans doute l'usine d'avions Heinkel, de l'autre côté du camp.
Désordre délicieux. On bavarde, on rit. Un SS surviendrait qu'on se foutrait de sa gueule. Hum. Peut-être. C'est quand même toujours lui qui tient le bon bout du pistolet le plus proche.
Heraus! Antreten! Zu fünf! On rentre au camp. Parcours du matin, en sens inverse. Le porche. ARBEIT MACHT FREI. Les SS ne nous comptent même plus. C'est ça, le délabrement.
En temps normal, la colonne rentrant au camp s'en va droit vers les baraquements et se désintègre. Aujourd'hui, virage à droite aussitôt le porche franchi. Les potences sont dressées là. On nous fait passer à ras. Trois hommes y sont pendus par le cou, un écriteau sur la poitrine où l'on peut lire, en diverses langues: "J'ai pillé". Ce sont trois Muselmänner, hâves, déguenillés. Aucune démonstration d'émotion parmi les détenus qui défilent: la mort est trop quotidienne pour que trois cadavres impressionnent. Mon voisin sur le rang, un Français, dit: "Ah, ça n'est pas bien de piller".
Triomphe du nazisme? Indécrottable bêtise du défenseur de l'ordre à tout prix? Je contemple ce chien qui lèche la main de celui qui le bat. Les nazis l'affament, l'exploitent, menacent sa vie à chaque instant, le méprisent, lui crachent à la figure, et lorsqu'ils assassinent ses compagnons de chaîne, il leur trouve des justifications!
Hypothèse la plus probable de ces pendaisons: bombardement du camp, les Chleuhs craignent le désordre, il faut nous faire peur. Ils attrapent les trois premiers détenus qui leur tombent sous la main, ceux qui courent le moins vite, les pendent et les affichent en bonne place.
Deuxième hypothèse: les pauvres gars ont vraiment pillé et ont été pris. Mourants de faim, ils ont cru voir là une occasion de manger un peu? Dans ce cas comme dans l'autre, victimes des nazis.
Les jours suivants, on retourne au travail, mais le coeur n'y est plus. Il y a vraiment peu à manger. Même mon copain tchèque n'arrive plus à organiser sa ration de pain supplémentaire. On bute un peu partout sur des Muselmänner mourants ou morts. Les charrettes des ramasseurs de cadavres, avec leur attelage de détenus, ont bien du mal à suivre.
Les brutes, les excités, aux coups de poings et de pieds faciles, font preuve d'un grand calme et d'une politesse exquise. La probabilité qu'une de leurs victimes ait l'occasion de leur couper la gorge est une idée qui commence à pénétrer leur cervelle, malgré l'étroitesse du lieu.
Mais, bordel! que fait l'Armée Rouge? Voilà plus de deux mois qu'ils sont à cinquante kilomètres de nous.
Zerfall [48]. |
| | À la Glorieuse Armée Rouge qui m'a débarrassé
de la Bête Immonde! |
| | Le 15 avril 1945, gonflée à bloc, l'Armée Rouge attaque. Les Chleuhs se battent comme s'ils n'avaient pas déjà perdu la guerre. Mourir pour la patrie...
Le 20 avril, on ne va pas au travail. Le 21 on tourne en rond. La rumeur annonce l'évacuation du camp. Yuri me dit qu'on va séparer les nationalités. Il craint les derniers soubresauts de la bête immonde. Lorsque je veux me glisser parmi les Polonais pour que nous restions ensemble, il n'est pas d'accord: les Polonais pourraient bien être des cibles prioritaires, et il préfère pouvoir se débrouiller seul, que d'avoir un petit Franzoze à la traîne! D'autant plus que la découverte d'un Français dans le groupe pourrait servir de prétexte aux SS pour quelque connerie.
Appel des Polonais. Yuri part. En fin d'après-midi: "Die Franzozen! Los! Los!" On appelle les Français. En colonne par cinq, un pain entier - entier! - par détenu, on forme des groupes de cinq cents, encadrés de SS [49].
Tiens! Personne ne nous compte à la sortie, personne ne nous dit de marcher au pas, ni de tourner la tête vers le gradé préposé au comptage: plus de préposé! J'ai pris ma couverture et je l'ai mise en bandoulière. On marche d'un pas lent. La campagne est de sable et de pins. On prend un chemin de terre, sans doute pour ne pas encombrer les routes et gêner les mouvements de troupe.
Où allons-nous? Nul ne le sait. A voir la position du soleil je peux dire qu'en gros, c'est vers le Nord-Ouest[50]. On fuit devant les Russes. Fuite inexorable: à celui qui n'en peut plus, qui s'arrête, qui tombe, un SS tire une balle dans la nuque. Les cadavres sur l'épaulement du chemin sont de plus en plus fréquents, telles des bornes qui permettraient de mesurer, non pas la distance, mais l'épuisement.
Parfois on bivouaque dans un bois, parfois on campe dans une grange. Il arrive même, une fois, qu'un paysan nous donne des pommes de terre. Parfois on vole une betterave aux vaches. Le plus souvent il n'y a rien. Hormis le pain du départ - il n'en reste guère le troisième jour - aucun ravitaillement n'est prévu. On traverse un village. Sur la place une Schwester[51] de l'armée allemande, entourée de SS, rit avec eux. Quelques détenus tendent vers sa croix rouge leur gamelle. Elle crache dans leur direction. Les SS s'esclaffent.
Parfois on croise des colonnes de paysans à charrettes pleines de bric-à-brac, version 1945 et allemande des réfugiés sur nos routes de 1940. Des avions surgissent, on se jette sur les bas-côtés, ils mitraillent plus loin.
Ça commence à bien faire, les avions! Les Allemands au début de la guerre en France, puis en Angleterre, les Italiens et les Français à Gibraltar, les Anglais et les Américains en France et en Allemagne, et à présent: les Russes! Il ne manque à ma collection que les Japonais.
On n'a plus de pain depuis déjà quelques jours. Des détenus possesseurs de couteaux - comment? Organisés, bien sûr - sont parvenus à découper des morceaux du cadavre d'un cheval, mort mitraillé, qu'ils gardent jalousement. C'est le Printemps, les bourgeons de bouleau ont éclaté. Mangeables? Cueillette, bouillie, avec quelques pissenlits, ça fait un plat d'épinard...
Des camions nous rattrapent, s'arrêtent. Vides. C'est la Croix-Rouge suédoise. Ils ont déjà distribué leur chargement de colis. Ça fait quand même plaisir de les voir. Ils embarquent les plus faibles, et ils assurent nos SS que la guerre est perdue pour eux, qu'il y va de leur intérêt de cesser de tuer ceux qui ne peuvent plus marcher. Les SS comprennent. La marche reprend, les détenus qui s'affalent sur le bord de la route sont encore vivants lorsque la colonne les abandonne.
Le soir du 2 mai, on s'arrête à la lisière d'un petit bois en contre-bas de la route, et on s'apprête à bivouaquer. Regards circulaires: y a-t-il des pissenlits? Des pousses de bouleau?
Les SS sont en groupe, le chef nous appelle. Discours: "Les Russes approchent, nous ne nous arrêtons pas, nous allons marcher toute la nuit. S'il y en a parmi vous qui veulent nous suivre, ils le peuvent, nous les protègerons."
Je jouis de l'humour de la situation, dont ils semblent inconscients. Je peux les suivre si je veux bien. Si je veux bien, ils veulent bien! Quels bons petits SS nous avons là! C'est la première fois depuis longtemps que j'ai envie de rire.
Mais soyons sérieux: la nuit va bientôt tomber et il me faut récolter des pousses de bouleau et des pissenlits pour le dîner. Un petit feu: les branches mortes de bouleau font une flamme vive. Encore une gamelle 'd'épinards', et je me roule dans ma couverture, par terre, sous un sapin. La nuit est noire et froide, pas une étoile. |
| | [1] Silence!
[2] Détenus. Nous ne sommes pas prisonniers, mais détenus.
[3] Un pou, ta mort.
[4] Camp de concentration.
[5] Ce n'est qu'après la guerre que j'ai entendu parler des camps comme Auschwitz, Mathausen, etc., cercles encore plus profonds de l'enfer...
[6] Rien ne garantit l'exactitude de ces étiquettes; l'absurdité ambiante encourage le doute: il est plus que probable qu'ils sont nombreux à porter un triangle d'une catégorie à laquelle ils n'appartiennent pas.
[7] Le doyen, le chef de la baraque 37.
[8] Les nazis ont inventé le "Newspeak" (que J.D.Jurgensen traduit par "novlangue") bien avant le '1984' de George Orwell. Quarantaine, le travail c'est la liberté, les exhortations bien pensantes inscrites sur les murs des Blocks, autant de détournements du sens des mots.
[9] Matraque faite d'un tronçon de câble électrique .
[10] Halte! Garde-à-vous!
[11] Debout! Vite! Dehors!
[12] Ein Stuck: une tête de bétail. Genau: exact.
[13] Le concentrationnaire n'est pas seul dans ce cas: le panda, qui possède un système de digestion de carnivore, ne se nourrit que de bambou, est obligé de passer 60% de son temps à manger et à déféquer, incapable comme nous d'assimiler la fibre qu'il ingère.
[14] Chef de service d'une aile de Block.
[15] Hommes de service.
[16] Dans la hiérarchie raciale nazie, les bons aryens - les Allemands, les Scandinaves, et d'une certaine manière les Britanniques - étaient les êtres supérieurs; les latins nettement en dessous, les gens de l'Est - Polonais, Russes - tout juste bons à être esclaves; quant aux Juifs, Noirs, et autres Gitans...
[17] Rien n'est simple. Là aussi il y a un prix à payer. En ne me laissant pas faire, je prive mes amis de la nourriture qu'une situation privilégiée m'aurait permis d'organiser...
[18] Nous ne nous verrons plus jamais. Transporté dans un autre camp, il y est mort. Il était, avant la guerre, instituteur à Malakoff, au Sud de Paris.
[19] Sans doute les essais des premiers avions à réaction, encore inconnus de l'homme de la rue.
[20] Donne! Donne! Viens ici! Vite! Porter patates! (La langue est ce que l'on appelle "lagerdeutsch", un parler qui emprunte aux diverses langues emprisonnées).
[21] Les Français, ça se branle tout le temps!"
[22] Contremaître
[23] Ça va pas la tête, mec?
[24] Je ne suis pas certain de ces numéros.
[25] Les yeux à gauche! Enlevez le béret!
[26] Un! deux! trois! quatre! gauche! gauche!
[27] En principe au pas de l'oie, mais les SS n'essaient même plus de l'imposer: toutes ces races sont trop inférieures pour en maîtriser les subtilités .
[28] On y fabriquait des masques à gaz .
[29] Un travail à risque et à récompense: on trouve des trésors dans ces ruines, mais aussi des bombes à retardement.
[30] Fais gaffe!
[31] Il est mort en décembre 1944. Exemple parfait du gâchis que représente la guerre: 23 ans d'effort et d'amour pour faire cet homme courageux et intelligent, et on le jette...
[32] Cette rencontre reste pour moi un mystère. Est-ce vraiment le fruit du hasard? Ou bien l'organisation clandestine du camp en examinant les arrivées du convoi de Lille a-t-elle repéré sur le fichier un radio clandestin de la France Libre? Mais si j'existais sur un fichier, les SS y avaient accès... et m'auraient laissé en vie?
Je n'ai jamais pu retrouver trace de Yuri. Après toutes ces années, je ne suis même plus sûr de son nom! Yuri, si tu lis ça...
[33] Musulmans.
[34] Organiser, dans le langage du camp: se procurer un avantage hors normes. Le plus souvent au détriment de la masse des détenus, parfois de celui des SS. C'est le mot clé de la vie, de la survie. Cela va de la gamelle de rab pour un petit service rendu, du raid à découvert d'un groupe de jeunes Ukrainiens contre les charrettes de betteraves - défiant les coups des Kapos de garde, la mort s'ils sont pris - aux transactions les plus complexes, incluant des civils travaillant aux côtés des détenus, ou les SS eux-mêmes.
La nourriture volée aux détenus par divers Prominenz - chefs de Blocks, Kapos des cuisines, etc. - alimentait un commerce considérable dans le camp...
[35] Bureau du travail.
[36] Deutsche Ausrustungs Werke - Usines Allemandes d'Equipement.
[37] J'ai écrit à Siemens pour leur demander s'ils avaient des archives de ce temps-là. Ils m'ont répondu qu'ils n'en retrouvaient point.
[38] Très courtes pour l'époque, c'est-à-dire de deux à cinq mètres. Je les connaissais avant la guerre, un de mes amis, radio-amateur, s'en était procuré une paire - rares et précieuses! - et nous avions fait des essais, techniciens à la pointe du progrès, croyions-nous. Et ici il y en a des caisses débordantes!
[39] S'il vous plaît Monsieur!
[40] Ce n'est qu'après la guerre, lorsque j'ai visité le camp en touriste, que j'ai appris à quoi il servait.
[41] J'apprendrai l'existence, après la guerre, d'un quartier cellulaire où des atrocités invraisemblables ont été commises; celle d'un lieu d'exécution caché; celle d'un atelier de faux-monnayeurs, le Kommando Bernhardt - nommé après le SS Sturm-bannfürher Bernhardt Kruger - où l'on fabriquait des billets de banque anglais et des dollars. (Les SS, là, n'ont rien inventé: en 1794 les Anglais ont émis de la fausse monnaie pour déstabiliser la Révolution française; en 1849 les révolutionnaires hongrois impriment des faux billets autrichiens; en 1918/22, pendant la guerre civile russe, chaque côté émet de la fausse monnaie pour embêter l'autre...).
Les faux billets nazis étaient, entre autre, écoulés par un nommé Schwend que, plus tard, on retrouvera au Pérou, sous le nom de Don Federico Schwend, un bon ami de Klaus Altmann, nom sud-américain de Klaus Barbie.
[42] Schuhe Kommando: équipe des chaussures. Sonderlager: camp spécial. Strafkompanie: compagnie punitive.
[43] Ces prisonniers de guerre anglais ont été assassinés par les nazis avant la libération du camp.
[44] À Berlin, une nuit, la gestapo arrête deux détenus et deux SS dans un cabaret, en train de sabler le champagne avec des hôtesses. Les deux détenus, triangles verts, étaient préposés à KANADA - la mine d'or du camp - où on conserve les possessions et les vêtements des détenus qui arrivaient au camp. Ceux qui y étaient employés pouvaient à loisir fouiller et découvrir dans les doublures, les coutures de vêtements, les semelles de souliers - des diamants, des dollars, des pièces d'or, cachés par leurs propriétaires déportés de chez eux par les nazis. Avec ces trésors - le SS résiste à tout sauf à la tentation - ils avaient soudoyé les SS et 'organisé' cette virée.
[45] Il est probable que Yuri appartenait à une telle organisation clandestine du camp, qui aurait décidé de mettre le radio de Londres à l'abri dans ce havre électronique. À l'époque je n'en ai rien su, sans doute pour les évidentes raisons de sécurité, mais je pense leur devoir ma survie.
[46] Oberkommando des Wehrmacht: l'état-major suprême de l'armée.
[47] Hommes de la Défense Passive
[48] Décomposition.
[49] Le lendemain, des éclaireurs soviétiques libéreront le camp.
[50] On a dit qu'il y avait un plan d'embarquer les concentrationnaires dans des navires à partir de Lübeck, puis de les couler...
[51] Infirmière. |
| |
|  |
|